Dossier de presse
Nuits Théâtrales Marlenheim
Cèdre d’Or du meilleur spectacle de plein air de la circonscription, Duttlenheim 2006.
Oscar (Bonzini) des Cèdres d’Or du meilleur spectacle de plein air de la circonscription, Mutzig 2011
Quand le ciel se fâche...
Nuits Théâtrales Marlenheim
Cèdre d’Or du meilleur spectacle de plein air de la circonscription, Duttlenheim 2006.
Oscar (Bonzini) des Cèdres d’Or du meilleur spectacle de plein air de la circonscription, Mutzig 2011
Quand le ciel se fâche...

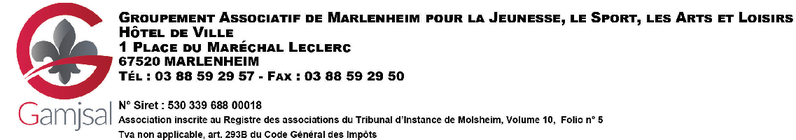
Note de présentation
Depuis 1989, les Nuits Théâtrales de Marlenheim présentent tous les deux ans un spectacle en plein air, sur une dizaine de représentations. L’ambition, tout au long des seize pièces présentées, est de raconter une page de l’histoire de la commune, et plus largement de celle de l’Alsace. De 589 à 1961, tous les grands événements qui ont marqué la région ont ainsi été représentés. Ainsi, la pièce « Enfin parlons-en », qui raconte la période 1939-1945, produite en 2011, a été reprise au Mémorial d’Alsace-Moselle de Schirmeck, et filmée par Alsace 20. Il s’agit en effet de théâtre, et pas seulement de spectacle en plein air. Une centaine de personnes, issues du monde associatif de Marlenheim, participe à cette aventure artistique et humaine : auteur, metteur en scène, régisseur, acteurs, figurants, techniciens et administratifs, donnent ainsi leur impulsion à la vie culturelle de la cité. A côté du Mariage de l’Ami Fritz et de la Fête du Livre, ces nuits théâtrales, ancrées depuis maintenant plus de trente ans dans une tradition, poursuivent leur triple pari : un pari didactique, un pari artistique, un pari citoyen.
Les Nuits Théâtrales de Marlenheim proposent, tous les deux ans, en alternance avec la Fête du Livre, de ressusciter un événement du riche passé de la commune.
L’objectif est triple :
- fédérer les forces vives de la commune dans un projet qui mobilise près d’une centaine de personnes, toutes compétences confondues ;
- enseigner l’histoire de leur région à des spectateurs potentiellement intéressés par elle ;
- produire un véritable événement culturel, accessible à un large public, certes, mais dégageant en même temps du sens : il s’agit ici de théâtre, et pas seulement de spectacle.

Seize expériences fort concluantes retraçant des moments historiques de notre cité ont déjà été tentées depuis 1989 :



- En 1989, dans le cadre du 1400ème anniversaire de la commune ; la pièce de théâtre « Les Amants Diaboliques », écrite et mise en scène par Paul Sonnendrucker, retraçait la conjuration ourdie à Marlenheim contre le jeune Childebert (VIe siècle).
- En 1991, Paul Sonnendrucker mettait en scène un nouveau spectacle théâtral de plein air
- « Richarde, Cœur de Lion », qui racontait l’histoire de Richarde, Impératrice alsacienne, patronne de la Paroisse de Marlenheim (IXe siècle).
- En 1993, « Les Vendanges de la Paix », 3e épisode consacré à la Guerre de 30 ans, était écrit par Gabriel Schoettel, originaire de la commune et mise en scène par Marcel Grandidier.
- En 1995, « Les Raisins de la Colère », pièce écrite par Gabriel Schoettel et mise en scène par Yves Grandidier avait pour thème la guerre des paysans.
- En 1997, Yves Grandidier mettait en scène un épisode de sorcellerie dans « Les Démons de la Saint-Jean » écrite par Gabriel Schoettel.
- En 1999, « Le Fléau » (pièce écrite par Gabriel Schoettel et mise en scène par Yves Grandidier) retraçait une épidémie qui avait ravagé Marlenheim au printemps 1786.
- En 2001, Yves Grandidier mettait en scène « Les 7 demoiselles de Marlenheim » (écrite par Gabriel Schoettel) qui s’inspirait d’une légende célèbre à Marlenheim : les maisons à tourelle.
- En 2003, « L’Amie Friedel » se joue en 1864, année où paraît à Paris l’Ami Fritz, et cette même année est inaugurée la voie de chemin de fer Wasselonne-Molsheim, qui passe par Marlenheim.
- En 2005, « Un Tramway nommé Delsor » retrace l’arrivée du Tramway à Marlenheim en 1903, à une époque où l’Abbé Delsor, figure majeure de l’Alsace de cette époque, farouchement pro- français dans une province qui ne se sent pas vraiment persécutée, est curé de Marlenheim.
- En 2007, dans « A l’ombre des jeunes filles en bleu » on retrouve Friedel dans le cadre de l’école ménagère Sainte-Richarde, fondée par l’Abbé Delsor, qui assiste aux joutes qui déchirent l’Alsace de 1924-1925, et qui ont leur chambre d’écho dans le canton et la commune.
- En 2009 et 2011, à Marlenheim et au Mémorial d’Alsace-Lorraine à Schirmeck, « Enfin parlons- en ! » aborde le « trou noir » de l’histoire en Alsace, à savoir la période 1939-1945 que très rarement « représentés » au théâtre en Alsace (sauf, évidemment, l’incontournable chef d’œuvre de Germain Muller, arbre qui cache... le vide). Une mise en abyme : l’histoire (l’Histoire ?) est vue à travers des regards d’élèves d’aujourd’hui (en 5 tableaux contemporains) qui vont en maison de retraite recueillir des témoignages d’autrefois qui prendront vie en 5 tableaux historiques dans une mise en scène d’Yves Grandidier à la fois sobre et empreinte de modernité.
- En 2013, « Malgré tout », retrace le retour des Malgré-Nous en 1945 : l’attente des familles en Alsace et le retour des prisonniers.
- En 2015, « Cette année-là 1953 » relate l’épisode du procès de Bordeaux où des jeunes alsaciens ont été condamnés puis « graciés » pour avoir « Malgré eux » participé à la tragédie de l’incendie d’Oradour sur Glane.
- En 2017, « De la boue au bâton » retrace la vie d’un village alsacien au début des années 60 avec le remembrement des terres agricoles et l’apparition des premières zones commerciales.
- En 2019, « Sous les pavés la place », un slogan qui fait bien sûr écho au célèbre mot d’ordre de mai 68, à Strasbourg avec ses effets dans les campagnes alsaciennes.
- En 2022, « Sacré collège ! », la mobilisation autour d’un projet éducatif ambitieux, rivalités de territoires, combats de coqs ponctuent cette comédie qui mêle réalité et fiction, fidèle à la devise : « Instruire en divertissant, divertir en instruisant ».
L'auteur
Gabriel SCHOETTEL

Agrégé de Lettres retraité, chargé de mission au Rectorat pour l’option Langue et Culture Régionales, Gabriel Schoettel est romancier et dramaturge. Auteur d’une quinzaine de romans aux éditions Oberlin et du Verger, il a écrit autant de pièces de théâtre, notamment toutes celles des Nuits Théâtrales depuis 1993. Par ailleurs auteur du livret de l’opéra Luther ou le mendiant de la Grâce, joué dans une dizaine de lieux en Alsace et en Lorraine, il est aussi l’auteur de « Vergissmeinnicht / Ne m’oublie pas » : cette dernière pièce, produite par le CIAS de Niederbronn en 2022, a été jouée une douzaine de fois à travers la région par la troupe professionnelle de BAAL Theater en 2023.
Elle sera rejouée en 2024, suivie d’interventions de l’auteur dans les classes de troisième ; sa traduction en allemand sera jouée à partir du mois de janvier en Allemagne. Les thèmes de prédilection de Gabriel Schoettel concernent la recherche de la vérité impossible, le passé qui ne passe pas et le travail sur la mémoire. A Marlenheim, il s’attache à faire connaître des pages oubliées de l’histoire de la commune, sous une forme qui permet à un large public de la découvrir, fidèle à la formule de l’éditeur Hetzel : « Instruire en divertissant, divertir en instruisant ».

Le metteur en scène
Yves GRANDIDIER

Animateur et conférencier, il a fait ses premiers pas au théâtre comme comédien avec Paul Sonnendrucker aux 1ères Nuits Théâtrales de Marlenheim en 1989, puis aux Comédiens du Rhin où il assure sa première mise en scène en adaptant Gaslight de Patrick Hamilton en 1992. Depuis, il a réalisé la mise en scène des 15 dernières éditions des Nuits Théâtrales de Marlenheim. En 1994, il goûte au théâtre dialectal en intégrant le Cabaret d’Waeschbritch. En 1995, il crée le Cabaret bilingue la
« Budig » qui présente chaque année depuis 28 ans une nouvelle revue satirique, caricaturant la vie quotidienne et politique de ses concitoyens en alsacien et en français, en sketchs et en chansons. Yves Grandidier a également tourné dans de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles et notamment dans le pilote de la série régionale Hopla Trio en 2013, ainsi que dans de nombreux courts métrages. Pour les festivités de l’an 2000 à Hochfelden, il a écrit et mis en scène une fresque historique en 6 tableaux : « Entre Pierre et Clé » ainsi qu’un conte musical : « L’homme de la Zorn » en 2004.
En 2002 et 2003, il obtient le 2e prix de Poésie Dialectale avec Errinerung et d’Lieb au Prix Littéraire du Pays de Neuf-Brisach, un 1er prix de Poésie Alsacienne au Prix Littéraire du Centre Européen pour la Promotion des Arts et des Lettres à Thionville en 2004 ainsi qu’une mention spéciale du Jury du prix Conrad Winter au Festival Summerlied en 2008. Avec sa passion du spectacle vivant et de l’Alsace qui le caractérise, Yves Grandidier et la « Budig » se voient décerner un Bretzel d’Or en 2005 par l’Institut des Arts et Traditions Populaires d’Alsace pour leur engagement et leur œuvre
en faveur de l’Alsacianité. Yves Grandidier était également Directeur Général (retraité depuis 3 ans) à l’ATE aujourd’hui APEDI Alsace, association qui gère des établissements et services pour personnes déficientes intellectuelles. Mettre en scène une pièce (tragique ou comique) écrite par Gabriel Schoettel reste un exercice souvent périlleux pour marier géographie du lieu de représentation (place de la Mairie) et sujet de l’action des 18e Nuits Théâtrales : « Quand le ciel se fâche... ».
Pour donner aux spectateurs l’illusion animée de l’ampleur de cette catastrophe naturelle qui s’est abattue dans les rues d’un village alsacien à flanc de colline, un décor léger et flottant sous forme de tissu imprimé pouvant onduler au gré du vent apparaissait comme une réponse adaptée. Pour cela, il s’est attaché du pouvoir créatif des élèves et de leurs professeurs de l’Institut Supérieur des Arts Appliqués de Strasbourg qui réaliseront les graphismes et de l’entreprise FABEON, une « microfactory » dédiée à l’impression numérique et qui est chargée de l’impression.
Les choix de mise en scène de cette nouvelle édition des Nuits Théâtrales de Marlenheim offriront aux spectateurs l’occasion de se laisser transporter par le jeu des comédiens, par l’environnement théâtral dans lequel ils évolueront, par la musique qui les accompagneront, bref, d’être les témoins d’un spectacle vivant du XXIe siècle témoignant des forces de la nature de la fin du XXe siècle.
Note d'intention
Les Nuits Théâtrales de Marlenheim ont toutes traité de thèmes relatifs à l’Histoire (souvent avec « Une grande hache »). Jusqu’à la fin du XXe siècle, celle-ci ne se concevait qu’à travers un prisme politique, sociologique, économique. C’est-à-dire humain : l’homme prométhéen était in fine toujours vainqueur. Mais voilà qu’en 1974, puis en 1981, apparaissent les premiers « écologistes », René Dumont, Alain Bombard, qui nous mettent en garde : nous vivons dans et avec un environnement que nous devons respecter pour pouvoir survivre dans et avec lui. À défaut, celui-ci se venge.
Les catastrophes naturelles sont toujours sidérantes, par leur soudaineté, leur rapidité, leur ampleur, leurs conséquences. C’est ce que s’efforcera de montrer cette pièce. Des phénomènes aussi courants, et qui se croient « innocents », que ceux de la bétonisation, de la construction à outrance de lotissements, de la mécanisation de l’agriculture, ont des conséquences inattendues.
La pièce s’attache à montrer ces conséquences et à en tirer quelques enseignements. Mais la catastrophe naturelle a aussi des effets inattendus sur les relations humaines, où de nouvelles solidarités et d’autres alliances se nouent. Ces aspects-là permettent de ne pas désespérer de l’espèce humaine, et c’est pourquoi ils apportent une note optimiste et souriante à ce qui risquerait d’être trop dramatique.
Enfin, au cœur de cette comédie dramatique, il paraissait important de montrer que l’amour entre deux adolescents est totalement indifférent au monde extérieur, et qu’il triomphe de toute adversité : ils seront le symbole de l’éternelle espérance.
Ces problématiques ont bien entendu été à l’œuvre à Marlenheim le 22 juillet 1982, lorsque la commune a été confrontée aux conséquences dramatiques d’un orage particulièrement violent. Mais si les causes, les effets et les suites de ce déluge-là peuvent servir de prétexte et parfois d’illustrations à la pièce, celle-ci s’autorise toute liberté pour dépasser la réalité brute des faits. Car, comme le proclamait Virginia Woolf,
« plus les faits sont vrais, meilleure est la fiction ».

Synopsis
1/ Mardi 22 juin 1982, milieu de l’après-midi, au restaurant « Au Boeuf » de Merledorf
Autour du flipper, les jeunes échangent sur l’année passée, le collège, le lycée et les examens. Ils évoquent aussi les vacances à venir, les amours et amitiés. Aux tables, les échanges entre hommes se font sur la politique nationale et locale, puis sur l’extension prévue du lotissement : les pour et les contre s’affrontent. On échange aussi sur les méthodes de culture de la vigne et du tabac. Les discussions sont rythmées par des grondements de tonnerre : l’orage éclatera-t-il ou passera-t-il chez le voisin comme tout le monde le souhaite ? Chacun y va de son dicton et de son souvenir météorologiques.
2/ Mardi 22 juin 1982, fin d’après-midi dans la cuisine des Schweitzer
Monique Schweitzer prépare le repas tout en dictant un texte à son fils Laurent qui a des problèmes en orthographe. Quand Jean-Paul rentre (du restaurant, mais il prétend qu’il était retenu sur un chantier), une dispute éclate entre les époux à propos des tâches dans le couple. Jean-Paul se plaint aussi des nouveaux habitants, les Hergeloffeni, comme leurs voisins Lombardini, qui voudraient faire la loi et perturbent l’équilibre dans Merledorf alors qu’ils ne comprennent rien à la campagne. La fille des Schweitzer, Muriel, qui errait dans la cuisine, absente et extatique, les yeux rivés sur l’horloge, propose d’aller chercher des fraises dans le jardin, à l’étonnement du couple qui la croyait effrayée par l’orage, et lui recommande de rentrer au premier éclair. À peine est-elle sortie que les éclairs se précisent et qu’un coup de tonnerre éclate au lointain.
3/ Mardi 22 juin 1982, fin d’après-midi dans l’abri de jardin des Schweitzer
Sur le chemin du jardin, Muriel est interceptée par Laurent, qui veut la faire chanter, car il sait qu’elle veut rejoindre Romuald. Elle confie son amour à son petit frère mais aussi son angoisse : ils ne peuvent s’aimer que cachés, parce que ses parents et le monde entier seraient contre eux ! Mais l’amour triomphera ! Elle lui fait promettre le secret (elle a elle aussi des moyens de pression). Puis Muriel attend Romuald dans l’abri de jardin qui se trouve entre le jardin des Schweitzer et celui des Lombardini. Dans un monologue passionné, elle évoque son amour. Cependant que les éclairs se font plus violents et les coups de tonnerre plus bruyants, accroissant la frayeur de Muriel, arrive enfin Romuald. Les deux amoureux échangent des serments passionnés et filent longuement la métaphore sur le thème du coup de foudre, cependant que la vraie foudre semble frapper pas trop loin. Mais la pluie se met enfin à tomber, violemment, bruyamment, mettant fin à l’orage. L’eau envahit bientôt le jardin et monte dans la cabane.
4/ Mardi 22 juin 1982, la nuit est tombée, dans le couloir des Lombardini
Romuald rentre, trempé, plein de boue, chez lui. Il est accueilli par une paire de claques de sa mère, qui décharge ainsi sa nervosité, puis qui l’embrasse violemment : elle a eu si peur qu’il lui soit arrivé quelque chose! La famille est en émoi : tous les plombs ont sauté, ils s’éclairent aux bougies et à la lampe de poche ! Le père remonte de la cave et donne des nouvelles des dégâts : le congélateur est hors d’usage et les bouteilles de vin flottent partout. Puis ils regardent dans la rue où vient de passer une immense coulée de boue : dans la semi obscurité, on devine des machines à laver, des bouteilles de gaz, des amas de pierres, des tables et chaises de jardin, etc. On se hèle dans l’obscurité, se lamente.
5/ Mercredi 23 juin 1982, au matin, dans la rue des Lombardini et des Schweitzer
La lumière se fait sur un spectacle d’apocalypse : la boue a englouti la rue, où on distingue mieux maintenant ce qu’on devinait la nuit. Chez les Lombardini, la boue, après avoir tout emporté, recouvre le trottoir, le jardin et le garage. Un peu plus loin, chez les Schweitzer, la voiture est noyée sous la boue et le gravier, le congélateur, la machine à laver, la tondeuse et des outils sont hors d’usage, ainsi que la cabane. Il faut évacuer la boue, laver
à grande eau les abords ; pendant que les uns pellettent sur les brouettes, les autres évacuent le contenu de celles-ci sur des charrettes ou des camions : une grande solidarité règne. Les Schweitzer, Lombardini, d’autres riverains, la Maire, un opposant, discutent tout en travaillant : quelle est l’ampleur du désastre, ses causes, ses conséquences, on se dispute, s’invective, certains se réconcilient, les enfants s’en donnent à coeur joie dans les débris et la boue, Romuald et Muriel travaillent côte à côte et se bécotent parfois en douce. Les pompiers s’activent aussi.
6/ Mercredi 23 juin 1982, fin de matinée, dans la rue perpendiculaire à la rue des Schweitzer
Dans ce bout de rue, le plus gros des déchets a été évacué. Ne restent que la boue et des pavés arrachés.
Arrivent des soldats du 153ème RIMECA, pelles sur l’épaule, qui se mettent en devoir de dégager la boue. Arrive aussi l’Adjoint sur son tracteur qui tire une tonne à lisier : il va pouvoir évacuer la boue ! Il est pris à partie par les habitants qui lui reprochent, ainsi qu’aux autres viticulteurs, d’être responsable des dégâts (absence d’enherbement, arrachage des murets, remplacements des vergers par des vignes…) Toute cette scène se fait en présence et sous l’œil de la caméra d’un(e) journaliste de FR 3 : celui (celle)-ci, qui est parisien(ne), pose des questions idiotes et fait des commentaires lyriques et abscons.
7/ Samedi 26 juin 1982, dans une rue
La Maire, l’Adjoint et un(e) troisième membre du Bureau d’Aide Sociale vont de maison en maison faire le point des dégâts, s’enquérir des sommes évaluées et rappeler les différentes aides proposées (commune, département, état, assurances). Un premier habitant exagère manifestement l’ampleur des dégâts chez lui et demande des indemnités astronomiques. La deuxième, plus raisonnable, qui n’a que peu de dégâts, est cependant très pointilleuse et portée sur les détails. Le troisième monte sur ses grands chevaux et veut faire un procès à tout le monde (viticulteurs, commune, état) en criant au scandale. En quittant la rue, les membres du BAS font un premier bilan.
8/ Lundi 28 juin 1982, le soir, dans la salle du Conseil Municipal
Devant le public des habitants sinistrés, la Maire fait un premier bilan, souvent interrompue par des membres du Conseil. Ceux-ci accusent, s’invectivent, le public intervient aussi. La Maire récapitule, de manière anonyme, les dégâts chez les particuliers, en additionnant les sommes demandées. Réactions diverses. La Maire fait des propositions de gros travaux à entreprendre, qui sont diversement accueillies. Peu à peu, le débat dégénère, insultes et claques volent, cependant que se dessine un rapprochement entre Isabelle Lombardini et Eugénie. Pendant toute la séance, Muriel et Romuald, assis dans le public – mais derrière Jean-Paul – ont emmêlé leurs pieds et leurs mains et se sont chuchotés des mots doux.
9/ Samedi 9 juillet 1983, l’après-midi, à côté d’un bassin de rétention au milieu des vignes
Jean-Paul Schweitzer, Monique et des voisins arrivent, essoufflés, au bassin où se masse déjà une petite foule. Ils échangent sur l’année passée : le « tournant de la rigueur » en France, les travaux entrepris dans la commune, les évolutions au Conseil Municipal : Eugénie, en fine politique, n’a pas repris l’Adjoint-vigneron, mais a pris sur sa liste Isabelle Lombardini. On note de nouveaux clivages, les néo-ruraux veulent absolument que cesse l’immigration d’autres citadins : stop au grand remplacement et aux lotissements ! On arrive enfin au bassin qui va être inauguré. Eugénie en profite pour énumérer tous les travaux qui ont été entrepris afin d’éviter les déluges de boue : bassins, canalisations, murs… Chacun des aménagements cités est accueilli dans la foule par des commentaires sceptiques ou approbateurs. Enfin, Pierre Pflimlin décore Eugénie du Mérite Agricole, accompagné d’un discours. Là aussi, les commentaires fleurissent. La cérémonie se termine sous de gros nuages, puis des éclairs parcourent le ciel, le tonnerre gronde. Romuald et Muriel, main dans la main, courent vers la cabane de leurs premières amours : sous les éclairs et le tonnerre, le noir se fait, et on entend les dernières répliques sans plus les voir.

